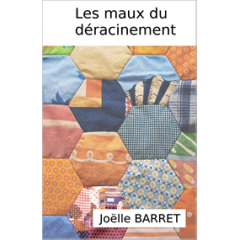Internet est une source d'information qui permet, à celui qui a des notions en Droit, de reconstituer la vie économique d'une entreprise. L'avénement des données ouvertes (open data) et des procédures en ligne accélère l'information. Là où avant la mise à jour de la situation d'une société mettait […]
Planète Eau › Océan indien › La Réunion

Aéroport de La Réunion, vu du parc de stationnement
Pendant qu'en métropole on l'imagine bercée par les vagues de la mer des Caraïbes et peuplée d'hommes et de femmes qui se prélassent au rythme du maloya, La Réunion est en fait une vouve dans l'Océan Indien : la vouve est le mot réunionnais pour désigner la nasse.
Comme le décrit Bienvenue dans l'arène
, l'île attire chaque année de nouveaux résidents. Certains ne feront qu'un court passage, le temps de percevoir un salaire indexé, pendant que d'autres viendront grossir les rangs des demandeurs d'emploi. Pour endiguer une démographie fortement croissante, des mécanismes de déplacement de la population sont régulièrement utilisés. Ceux-ci sont dépeints par Joëlle Barret, dans son livre Les maux du déracinement
. Les espoirs d'une économie dynamique expatriés vers la Capitale, le Canada, l'Australie ou autres, exposent à la précarité ceux qui sont restés sur place. Les services sociaux prennent alors le relais pour subvenir aux besoins des plus démunis, qui, tout en restant consommateurs, vont enrichir les grandes structures, voire les monopoles, de la distribution, des transports, du BTP, du logement, de la finance et du numérique. L'individu vit alors au rythme des indemnités et des allocations. Certes, cette particularité n'est pas spécifique à La Réunion, mais contrairement à la métropole, l'île regroupe sur une petite surface presque tous les niveaux de la société. De plus, elle se trouve fort éloignée du premier continent et n'offre que deux accès. Facile à observer et facile à isoler, La Réunion semble bien être un candidat idéal pour un laboratoire social.
18 mars 2024
Rumeurs ou comment une femme cupide devient vénale
Pour celui qui sait où chercher, Internet offre l'accès à de nombreuses sources ouvertes comme les sites de la presse régionale et ceux des journaux officiels. En les consultant et par recoupement, il est souvent possible de retracer l'histoire d'une personne, et en particulier celle d'un chef […]
22 févr. 2024
Rumeurs ou comment être haï sans raison

La rumeur circule dans les couloirs au rythme frénétique des talons d'une secrétaire qui s'enferme dans les vestiaires avec un ouvrier. Plus la fille sera voluptueuse et l'homme musclé, plus la rumeur se répendra, déclenchant par pur phantasme l'extase de tout un chacun. Arrivée aux oreilles de la […]
29 mai 2023
La face cachée de la Lune, au pays du Soleil levant
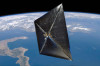
Le Challenge Terre - Lune consiste à aller photographier la face cachée de la Lune à l'aide d'une sonde qui partira d'une altitude de 50 000 km et naviguera uniquement à l'aide de la pression des rayons du Soleil sur une voile. Ce mode de transport permettra d'explorer le système solaire, voire le […]
3 févr. 2023
La retraite

Les réformes successives des retraites tendent à nous obliger de travailler plus longtemps pour percevoir moins, et chacun de nous y voit la perte financière subie. Mais est-ce que cette perte ne serait pas un écran de fumée qui dissimulerait un changement de la société beaucoup plus grave, comme le […]
11 févr. 2022
L'ego et le miroir

Avec l'arrivée de la téléphonie mobile et des réseaux sociaux, nous assistons à un renforcement de l'ego de jour en jour. Installez-vous à la terrasse d'un café et vous assisterez sûrement à la publication d'egoportraits (selfies en anglais) et de natures mortes (repas). Les artistes rivés sur leur […]
2 juil. 2021
Une fée numérique ?
Les réseaux sociaux font désormais partie de notre quotidien. Leur gratuité crée l'illusion d'un service public, alors qu'en fait, ils ne sont que des services proposés par des entreprises lucratives. L'utilisateur, aveuglé par l'expression de son ego, s'y exhibe, expose sa vie privée et dévoile son […]
20 juin 2021
Le chefaillon
La loi n° 2014-873 du 4 août 2014, a remplacé la notion de "bon père de famille" des textes législatifs, en respect de "l'égalité réelle entre les femmes et les hommes", par "raisonnable" ou "raisonnablement" : la notion retenue étant alors "la conduite […]
20 août 2020
Un robot dans une ancienne ferme de dinosaures

L'une des théories de l'extinction des dinosaures serait la chute d'une météorite de plusieurs kilomètres de diamètre, qui aurait frappé le Mexique, il y a soixante-cinq millions d'années. Depuis quelques années, en biologie, le mot "aves", désignant la classe des oiseaux, laisse […]
26 juin 2020
Et l'eau coule sous les ponts
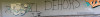
Pendant les deux mois du confinement, ils étaient restés bien silencieux, mais, avec l'approche de l'échéance, ils sont ressortis, faisant fuir les animaux qui s'étaient réappropriés la ville. Les oiseaux s'arrêtent de voler, laissant la place aux hommes politiques. 25 juin 2020, sur un fond social […]
29 janv. 2020
Quand l'humain devient Capital

Le progrès social est défini comme étant la recherche d'une amélioration des conditions de vie de l'être humain par un changement dans l'organisation sociale. Il est souvent associé au progrès technique, qui, lui, marque l'évolution de l'Etat de l'art. Mais ces deux notions ne sont pas équivalentes. […]
9 janv. 2020
Quand Bacchus honore Janus
Le premier janvier est aussi associé à la fête du dieu bifrons, dont l'un de ses visages regarde l'année écoulée, quand l'autre se projette dans la future. Mais la plupart des mortels l'ignorent et préfèrent rattacher le Nouvel an à la mort d'un pape, Saint-Sylvestre, et transformer ainsi la nuit du […]
29 août 2019
Bienvenue dans l’arène
Nommées "territoires", "collectivités" ou "départements", avec ou sans l'Europe, les anciennes colonies françaises sont toujours considérées comme des entités extérieures de la République. D'ailleurs, elles sont qualifiées d'Outre-Mer ou de régions ultrapériphériques. […]
13 févr. 2019
KAGAMI BIRAKI à La Réunion
Dans « Correspondances », Charles Baudelaire écrit, en parlant de la Nature : « L’homme y passe à travers des forêts de symboles, qui l’observent avec des regards familiers. Comme de longs échos qui de loin se confondent dans une ténébreuse et profonde unité [...] les parfums, les couleurs et les […]
17 févr. 2017
Un vilain garnement appelé Docteur
Il est des endroits propices aux méfaits, qui sans être indiqués dans l'Atlas des lieux maudits1, invitent à la transgression, uniquement par leur disposition. Et il est des invitations qui ne se refusent pas pour un enfant, dès lors quelles donnent l'illusion de perpétrer un crime parfait, et ce, […]
« billets précédents - page 1 de 2